Mur de refend : définition et caractéristiques

Le mur de refend est une composante essentielle de la structure d’un bâtiment. Portant des charges verticales et parfois latérales, il contribue à la stabilité générale de l’édifice. Sa conception, sa mise en œuvre et toute modification éventuelle doivent être réfléchies avec soin. Contrairement à une cloison classique, le refend est un mur porteur, capable de soutenir les planchers, les toitures et de participer au contreventement de l’ensemble. Voici ce qu’il faut savoir pour bien comprendre son utilité, les règles de construction à respecter, et les risques en cas de suppression.
Qu’est-ce qu’un mur de refend ?
Un mur de refend est un mur porteur placé à l’intérieur du bâtiment. Il se distingue des murs de façade qui eux, forment les limites extérieures de la construction. Le refend a pour fonction principale de reprendre une partie des charges du bâtiment, notamment celles exercées par les étages ou la toiture. Il contribue également à l’équilibre général de la structure, en répartissant les efforts.
Selon son orientation, il peut agir comme raidisseur transversal ou comme élément longitudinal de contreventement. Ce rôle structurel influe directement sur la disposition des pièces et la répartition des volumes intérieurs.
Orientation et impact sur l’organisation des pièces
Le sens dans lequel le mur de refend est construit a un impact direct sur la conception du bâtiment. Placé transversalement, il renforce la structure en reliant les murs de façade opposés, créant souvent des enchaînements de pièces en enfilade.
En position longitudinale, il soutient les planchers sur toute la longueur et peut générer une configuration en « corps-double » : deux rangées de pièces séparées par un couloir central. Le positionnement du refend influe donc autant sur la solidité que sur l’agencement intérieur. Il est souvent aligné avec l’axe du faîtage dans une maison traditionnelle.
Les matériaux utilisés pour un mur de refend
Comme tout mur porteur, le refend doit être bâti avec des matériaux robustes. On retrouve le plus souvent :
- des blocs de béton (cellulaire ou classique),
- des briques pleines ou creuses,
- du béton armé pour les structures les plus sollicitées,
- ou encore du bois dans les constructions à ossature.
Chaque matériau répond à des contraintes spécifiques (charge, isolation, budget), mais tous doivent être posés dans le respect des règles de stabilité et des normes en vigueur. Un mur de refend ne peut être improvisé : il exige une mise en œuvre rigoureuse et encadrée.

Comment construire un mur de refend dans les règles ?
La construction d’un mur de refend ne s’improvise pas. Elle nécessite une réflexion en amont et le respect de plusieurs principes structurels.
Une base solide avec des semelles de fondation
Pour garantir la stabilité du mur, il est impératif de créer des semelles de fondation sous la dalle. Celles-ci permettent de répartir le poids du mur sur une surface plus large et d’éviter tout affaissement. C’est une étape indispensable, même pour les murs porteurs intérieurs.
Deux méthodes de liaison
Par pénétration partielle
Le mur de refend s’ancre mécaniquement dans le mur extérieur. Cela se fait par des assises (rangs de maçonnerie) liées à au moins une assise sur trois, sur 5 cm de profondeur. Cette technique renforce la solidité du contreventement, mais doit être réalisée avec minutie pour ne pas fissurer les façades.
Par juxtaposition
Le mur est simplement monté contre le mur extérieur, sans l’intégrer à sa maçonnerie. Cette méthode est plus simple mais moins résistante mécaniquement, sauf si des renforts sont prévus.
Chaînage vertical et horizontal : renforcer la tenue
Pour éviter tout fléchissement, il est recommandé de renforcer le refend avec des éléments de chaînage, intégrés dans la maçonnerie. Ce chaînage, en acier ou en béton armé, permet d’absorber les mouvements et de limiter les risques de fissures structurelles. Il est particulièrement utile dans les zones sismiques ou dans les murs en brique.
Penser à l’isolation : traiter les ponts thermiques
Le point faible des murs de refend réside souvent dans leur jonction avec les façades. Ces liaisons mal isolées deviennent rapidement des ponts thermiques, responsables de déperditions de chaleur. Ces zones sont particulièrement sensibles au niveau des angles, des plinthes ou des dalles.
Pour les limiter :
- utilisez des rupteurs de pont thermique à la jonction mur/façade,
- complétez par une isolation intérieure continue,
- surveillez l’épaisseur du refend : plus elle est importante, plus le risque de fuites thermiques augmente.
Une bonne conception permet d’éviter la formation de condensation, de moisissures, et d’améliorer la performance énergétique globale du logement.
Peut-on supprimer ou modifier un mur de refend ?
Modifier ou abattre un mur de refend n’est jamais anodin. Étant porteur, il participe à la structure de l’ensemble du bâtiment. Le retirer sans précaution peut engendrer des affaissements, des fissures voire des effondrements partiels.
Avant toute intervention :
- un diagnostic structurel est nécessaire,
- des poutres porteuses ou linteaux doivent être mis en place pour reprendre les charges,
- l’avis d’un architecte ou d’un ingénieur en structure est vivement recommandé.
Dans une maison individuelle, une déclaration préalable de travaux peut suffire. En copropriété, l’autorisation du syndic est obligatoire, surtout si le mur est mitoyen ou concerne un plancher commun.
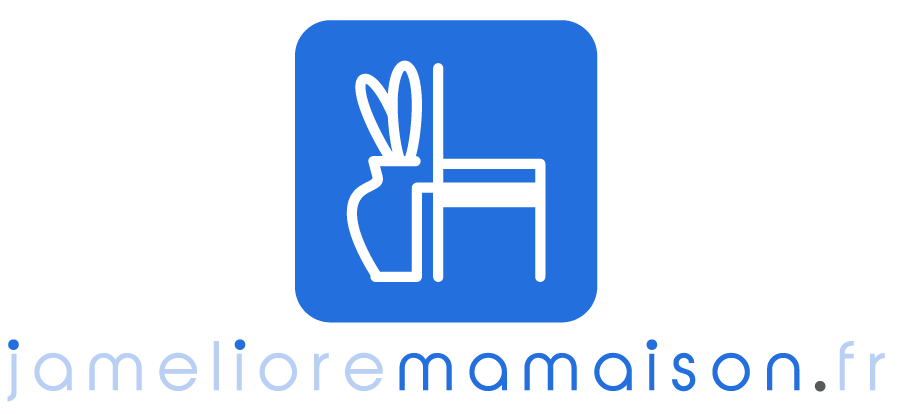
Commentaires
Laisser un commentaire